
Notre climat est t il en train de changer ?
Conséquence du réchauffement ou simple fluctuation naturelle ?
(voir aussi "An 2000 année la plus chaude" ou les inondations du Sud Est le 9 sept 2002)
Les météorologistes
ont disséqué la genèse des tempêtes hivernales de 1999.
Novembre 1999:
Deux jours d'orage seulement... mais en 48 heures, le département de l'Aude est noyé sous l'équivalent des précipitations d'une année.
Décembre 1999:
Deux tempêtes explosent en rafales
sur l'Hexagone, mettent la capitale cul par-dessus tête avant de poursuivre
leurs courses dévastatrices sur l'Europe. Les trois phénomènes extrêmes ont
eu lieu en un 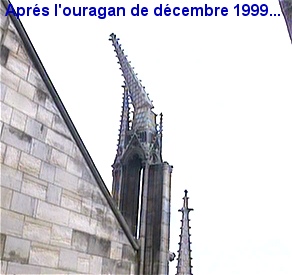 mois à peine. Et l'amalgame
entre ces événements dramatiques et le réchauffement de la planète est tentant.
Des rafales de vent à plus de 170 km/h, 80 % des forêts
françaises dévastées, plus de cinquante morts : les tempêtes de décembre 1999
furent parmi les plus dévastatrices du siècle. On les a dites historiques et
exceptionnelles. Ne sont-elles pas plutôt annonciatrices d'un dérèglement global
du climat ?
mois à peine. Et l'amalgame
entre ces événements dramatiques et le réchauffement de la planète est tentant.
Des rafales de vent à plus de 170 km/h, 80 % des forêts
françaises dévastées, plus de cinquante morts : les tempêtes de décembre 1999
furent parmi les plus dévastatrices du siècle. On les a dites historiques et
exceptionnelles. Ne sont-elles pas plutôt annonciatrices d'un dérèglement global
du climat ?
Notre temps est-il déjà détraqué ?
Ainsi, le déluge de
l'Aude ressemble furieusement à ces pluies d'intensité redoublée que décrivent
les modèles en cas de surchauffe de la planète. Mais le phénomène est récurrent
dans le Sud. Les tempêtes de décembre sont, en revanche, d'une trempe rarissime.
Leur trajectoire, le lieu même de leur explosion ont été disséqués par les météorologistes.
La vitesse des vents - 140 km/h en moyenne avec des pointes à 198 km/h enregistrées
sur l'île d'Oléron - est remarquable mais aussi c'est l'étendue du  territoire touché qui
fait d'elles un événement peu commun. Bretagne et Normandie avaient déjà essuyé
des vents à 160 km/h en octobre 1987, cette fois, c'est en effet plus de la
moitié du pays qui a été balayée par des rafales supérieures à 140 km/h. Du
jamais vu depuis vingt ans... c'est-à-dire depuis que nous disposons, sur l'ensemble
du territoire, de mesures fiables des valeurs extrêmes de vents. Autre source
d'étonnement : le très court intervalle entre les deux coups de vent qui ont
balayé le pays. La durée de retour de tels phénomènes serait supérieure à cent
ans pour un tiers des régions françaises. Les statistiques sont désormais pulvérisées
par nos deux tempêtes qui ont soufflé à 48 heures d'intervalle, les 25 et 27
décembre dernier.
territoire touché qui
fait d'elles un événement peu commun. Bretagne et Normandie avaient déjà essuyé
des vents à 160 km/h en octobre 1987, cette fois, c'est en effet plus de la
moitié du pays qui a été balayée par des rafales supérieures à 140 km/h. Du
jamais vu depuis vingt ans... c'est-à-dire depuis que nous disposons, sur l'ensemble
du territoire, de mesures fiables des valeurs extrêmes de vents. Autre source
d'étonnement : le très court intervalle entre les deux coups de vent qui ont
balayé le pays. La durée de retour de tels phénomènes serait supérieure à cent
ans pour un tiers des régions françaises. Les statistiques sont désormais pulvérisées
par nos deux tempêtes qui ont soufflé à 48 heures d'intervalle, les 25 et 27
décembre dernier.
Phénomène particulier ou général ? Que faut-il en penser ?
L'échelle de temps rapide à laquelle se sont formées, puis ont explosé les deux structures dépressionnaires dans l'atmosphère n'a, selon les météorologistes, que peu de rapport avec les grandes échelles qui régissent le climat d'une saison ou d'une année. Et donc avec un changement climatique global. Les spécialistes s'interrogent davantage sur le régime de temps particulier qui a permis qu'elles se dirigent droit sur nous. Les tempêtes ont certes éclos dans un nid propice, alors que la différence de pression était élevée entre Islande et Açores. Une différence qui pourrait même s'accroître, selon certains modèles. Mais il serait précipité de déduire un lien entre les bombes de décembre, leur curieux trajet et un réchauffement en cours. D'autant plus qu'un climat s'apprécie sur la durée et à l'échelle humaine on peut dire que la planète en a connu d'autres...
Ces terribles coups de vents ne pourraient-ils simplement obéir à un cycle naturel ?
On peut loucher du côté des pays nordiques, presque blasés à force d'essuyer de gros grains ou tempètes et dotés d'une expérience plus solide que la nôtre. Des chercheurs scandinaves ont reconstitué, sur une centaine d'années, les séries locales de vents sur le nord-ouest de l'Europe. Ils ne se sont pas fiés, bien entendu, aux enregistrements des capteurs de vents, mais aux mesures recueillies depuis des décennies par les stations météorologiques danoises, suédoises, norvégiennes et finlandaises. Puisque la force du vent est liée au creusement des dépressions, on peut en effet analyser les pressions indicatrices de la violence des tempêtes. Conclusion, quand ça souffle fort, ça souffle de plus en plus fort, et ce depuis le milieu des années 60. La Scandinavie nous aurait-elle livré la preuve que le temps se détraquerait peu à peu ? Pas vraiment. Tout d'abord, ce cycle semble toucher à sa fin. Ensuite, les pressions mesurées à la fin du XIXe siècle ont révélé des vents d'intensités comparables.
Faut-il craindre de plus en plus de phénomènes climatiques extrêmes ?
Après la synthèse de dizaines d'études, le climatologue détaille les aléas d'un climat plus chaud et probablement plus capricieux au XXIe siècle. Depuis que les scientifiques ont montré que l'homme agissait sur le climat de la planète, notamment par l'effet de serre, la question d'un bouleversement météorologique est devenue aussi légitime que pressante. Sur une Terre échauffée, le cycle de l'eau (évaporation et précipitation) est en effet plus intense, ce qui laisse prévoir des vagues de sécheresse, mais aussi une augmentation des fortes pluies. Elle atteindrait même 10 % sur l'Europe selon certains modèles, qui envisagent moins de jours pluvieux, mais plus intenses. Attendez-vous donc à essuyer des trombes d'eau en hiver et de belles giboulées au printemps. Avec à la clé, des crues et inondations plus fréquentes. Côté thermomètre, le nombre de jours très chauds augmentera à l'intérieur des continents tandis que diminueront les jours très froids. Le taux d'humidité grimpant, les pays tempérés pourraient même expérimenter la moiteur tropicale.
Faut-il alors redouter sa cohorte de vents à déraciner nos chataigniers ? Les tempêtes dévastatrices comme celle de l'an dernier vont-elles venir essuyer nos côtes plus souvent ?
Le risque de voir
apparaître des phénomènes extrêmes augmentera globalement sur la planète, mais
sans que l'on puisse nécessairement dire où. La machine thermique et hydrique
va augmenter, mais son activité est dynamique. On ne peut préciser si c'est
le Niger ou le Burkina qui seront touchés par la sécheresse, et encore
moins à quelle date ! Quant aux modèles climatiques intégrés pour le siècle
prochain, ils sont incapables de prédire un événement comme celui de décembre
1999. Les tempêtes et tornades sont trop petites pour se faire prendre et repérer
dans les mailles du filet numérique que les climatologues tissent autour de
leurs planètes virtuelles. Leur travail de modélisation, qui prend en compte
les phénomènes atmosphériques et leurs interactions
avec l'océan, permet de déceler de grandes tendances - comme celle du réchauffement
décrite par tous les modèles y compris les plus optimistes -, mais sans en détailler
l'histoire événementielle. A partir des modèles actuels, on peut comptabiliser
grossièrement les dépressions, leur intensité, et détecter un changement de
tendance. Les " tempétologues " surveillent aussi les conditions propices
à leur éclosion, traquant des indices à grande échelle et donc modélisables.
Un océan qui frémit à 28 °C en surface, par exemple, c'est autant d'énergie
disponible pour un cyclone en puissance. Pour les
tempêtes européennes, les chercheurs se focalisent plutôt sur la pression atmosphérique
en altitude, et plus précisément sur sa variabilité. Les études les plus récentes
pointent une augmentation de cette variabilité à l'intérieur d'un fameux rail
que suivraient ces tempètes. Selon des chercheurs de l'université de Cologne,
le gradient nord-sud de pression devrait même augmenter. La fameuse " Oscillation
nord atlantique " (ONA), sorte de balancier atmosphérique entre l'anticyclone
des Açores et la dépression d'Islande, pourrait, sous l'influence d'un effet
de serre accru, afficher un indice de plus en plus positif et favoriser de nouvelles
générations de tempêtes. La route des dépressions
risque également d'être modifiée.
sécheresse, et encore
moins à quelle date ! Quant aux modèles climatiques intégrés pour le siècle
prochain, ils sont incapables de prédire un événement comme celui de décembre
1999. Les tempêtes et tornades sont trop petites pour se faire prendre et repérer
dans les mailles du filet numérique que les climatologues tissent autour de
leurs planètes virtuelles. Leur travail de modélisation, qui prend en compte
les phénomènes atmosphériques et leurs interactions
avec l'océan, permet de déceler de grandes tendances - comme celle du réchauffement
décrite par tous les modèles y compris les plus optimistes -, mais sans en détailler
l'histoire événementielle. A partir des modèles actuels, on peut comptabiliser
grossièrement les dépressions, leur intensité, et détecter un changement de
tendance. Les " tempétologues " surveillent aussi les conditions propices
à leur éclosion, traquant des indices à grande échelle et donc modélisables.
Un océan qui frémit à 28 °C en surface, par exemple, c'est autant d'énergie
disponible pour un cyclone en puissance. Pour les
tempêtes européennes, les chercheurs se focalisent plutôt sur la pression atmosphérique
en altitude, et plus précisément sur sa variabilité. Les études les plus récentes
pointent une augmentation de cette variabilité à l'intérieur d'un fameux rail
que suivraient ces tempètes. Selon des chercheurs de l'université de Cologne,
le gradient nord-sud de pression devrait même augmenter. La fameuse " Oscillation
nord atlantique " (ONA), sorte de balancier atmosphérique entre l'anticyclone
des Açores et la dépression d'Islande, pourrait, sous l'influence d'un effet
de serre accru, afficher un indice de plus en plus positif et favoriser de nouvelles
générations de tempêtes. La route des dépressions
risque également d'être modifiée.
D'autres s'inquiètent de la recrudescence probable des cyclones dans l'Atlantique tropical. C'est le cas du dernier rapport WWF qui pointe le rôle du phénomène atmosphérique La Niña dans la formation d'eaux anormalement chaudes. A priori, l'est des côtes nord-américaines est la région la plus concernée. Mais une fois en fin de course, à l'ouest du bassin atlantique, tous ces cyclones ne pourraient-ils pas se transformer en dépressions, qui viendraient nous menacer à leur tour ? " Le lien entre ces résultats et la fréquence des tempêtes en Europe est loin d'être clairement établi ", tempère Serge Planton un émérite chercheur météorologiste. A la demande de plusieurs groupes d'assurances, il s'est livré à un exercice de compilation des études sur le sujet. Résultat ? Le vent qui souffle le plus fort est encore celui de la discorde, parmi les spécialistes ! Nul ne peut dire ainsi si toutes ces tempêtes en puissance menaceront la Bretagne, par exemple. Les études qui tentent de prévoir statistiquement leur trajectoire tirent à hue et à dia.
Selon un premier travail
allemand, un réchauffement provoquerait un déplacement vers le nord de la trajectoire
des tempêtes, sans rien changer à leur intensité. L'Institut de météorologie
néerlandais pointe, lui, le golfe de Gascogne et la mer du Nord comme sièges
possibles de perturbations renforcées, tandis que les tempêtes décroîtraient
sur le reste de l'Atlantique. " Plus d'eau évaporée en surface, c'est autant
de combustible disponible pour qu'un tourbillon se transforme en tempête ",
 soulignent enfin Catherine Senior
et Ruth Carnell, du Bureau météorologique de Grande-Bretagne. Leur modèle décrit
des tempêtes lancées sur des trajectoires habituelles, moins fréquentes peut-être,
mais surtout plus intenses. " En fait, les modèles se contredisent et sont
incapables de dire s'il faut redouter le retour plus fréquent des dévastations
de décembre 1999 ", déclare Serge Planton. " Quand bien même le taux
de tempêtes resterait stable, le niveau de la mer augmentera en raison du réchauffement.
Le moindre coup de vent pourra donc représenter une menace sérieuse pour les
régionsdu globe les moins élevées, rétorque Chris Folland, du Bureau météorologique
de Bracknell (Grande-Bretagne). On ne réduit pas les émissions de gaz à effet
de serre assez vite pour stopper leurs effets sur le climat au cours du XXIe
siècle. " Car les phénomènes extrêmes ont un coût de plus en plus élevé.
Et c'est le facteur humain, plus que le facteur météo qui en
soulignent enfin Catherine Senior
et Ruth Carnell, du Bureau météorologique de Grande-Bretagne. Leur modèle décrit
des tempêtes lancées sur des trajectoires habituelles, moins fréquentes peut-être,
mais surtout plus intenses. " En fait, les modèles se contredisent et sont
incapables de dire s'il faut redouter le retour plus fréquent des dévastations
de décembre 1999 ", déclare Serge Planton. " Quand bien même le taux
de tempêtes resterait stable, le niveau de la mer augmentera en raison du réchauffement.
Le moindre coup de vent pourra donc représenter une menace sérieuse pour les
régionsdu globe les moins élevées, rétorque Chris Folland, du Bureau météorologique
de Bracknell (Grande-Bretagne). On ne réduit pas les émissions de gaz à effet
de serre assez vite pour stopper leurs effets sur le climat au cours du XXIe
siècle. " Car les phénomènes extrêmes ont un coût de plus en plus élevé.
Et c'est le facteur humain, plus que le facteur météo qui en  est responsable.
Nos comportements sociaux, nos normes de sécurité sont sans doute à revoir.
Les tempêtes frappent des forêts plantées serrées, des villes qui explosent
démographiquement, des constructions installées dans le lit des rivières, ou
sur les surfaces d'imperméabilisation des sols et surtout des côtes bondées,
pas seulement en été. Il reste évident que concentrer son habitat dans ces zones
à risques reste encore le meilleur moyen d'alimenter les statistiques des catastrophes
avec des centaines de morts... (d'aprés un article de la revue Sciences et Avenir).
est responsable.
Nos comportements sociaux, nos normes de sécurité sont sans doute à revoir.
Les tempêtes frappent des forêts plantées serrées, des villes qui explosent
démographiquement, des constructions installées dans le lit des rivières, ou
sur les surfaces d'imperméabilisation des sols et surtout des côtes bondées,
pas seulement en été. Il reste évident que concentrer son habitat dans ces zones
à risques reste encore le meilleur moyen d'alimenter les statistiques des catastrophes
avec des centaines de morts... (d'aprés un article de la revue Sciences et Avenir).